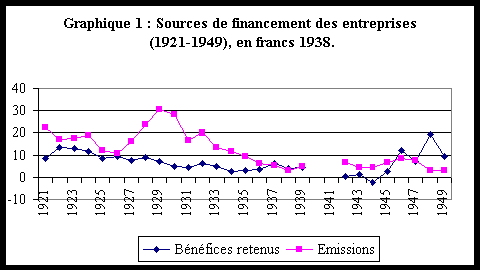
Source: Malissen, op. cit.
et tentative de cadrage macroéconomique
pour la France (1914-1990)
Ce texte est une version préliminaire
(et sans notes) de celui paru dans Entreprises et Histoire, n°22,
oct. 1999, 55-77.
Cet article souhaite présenter quelques réflexions
théoriques et méthodologiques sur l’autofinancement,
en guise d’introduction à une tentative de synthèse
macro-économique présentée par la suite, et aux
articles de nature plus
microéconomique qui suivent.
I. Quelques questions méthodologiques et théoriques
Pourquoi étudier l’autofinancement ? Et spécialement, que peut apporter ce concept à l’historien économiste ? Telles sont les deux questions qui vont d’abord nous occuper.
L’autofinancement n’est pas un concept simple. A la différence de nombreux concepts économiques, y compris le profit et l’investissement qui lui sont si liés, il n’est pas aisé à interpréter: les variations de l’autofinancement ne sont en elles mêmes ni bénéfiques, ni défavorables, qu’elles soient positives ou négatives ; un autofinancement élevé peut refléter aussi bien des profits importants qu’un investissement faible, et ne permet de rien dire aisément sur les causalités qui sont derrière: ainsi, un autofinancement élevé peut résulter de l’impossibilité pour une entreprise de recourir à un financement extérieur ou de l’absence de projets d’investissement suffisamment rentables. Certes, à l’échelle d’un grand nombre d’entreprises, la corrélation forte qui existe entre bénéfices réalisés et investissement est souvent vue comme le signe d’une contrainte freinant le financement externe et obligeant les entreprises à se financer sur leurs profits. Cependant, la véritable causalité peut être en sens inverse: les entreprises réalisant le plus d’investissements peuvent de ce fait être plus profitables, auquel cas apparaît la même corrélation. Une autre possibilité, qui n’exclut pas la précédente, est que les entreprises profitables investissent beaucoup parce que les profits d’aujourd’hui signalent la capacité à réaliser des profits élevés demain. Trancher entre ces différentes interprétations implique de distinguer les hypothèses sur lesquelles elles reposent et de confronter l’ensemble à l’observation empirique. Nous tentons ci-dessous dans un premier temps de préciser la place de l’autofinancement dans la théorie financière, puis envisageons les difficultés spéciales que rencontre l’historien à l’heure de l’examiner.
A. L’autofinancement dans la théorie économique contemporaine
1. Les questions
On considère habituellement deux raisons majeures d’étudier les formes du financement au niveau macroéconomique: leur impact sur la croissance économique et leur influence sur la conjoncture. L’analyse des liens entre structure financière et développement économique est ancienne (Schumpeter par exemple), mais elle a longtemps été abandonnée par les économistes qui soulignaient plutôt les causes réelles (i.e. non financières) de la croissance. Les Goldsmith, Shaw ou McKinnon, peu écoutés dans les années 1960 et 1970 ont cependant ouvert la voie à un renouveau des études reliant développement financier et croissance. Les historiens ont d’ailleurs joué un rôle non négligeable dans la construction de l’argumentation en ce sens.
Les liens envisagés sont multiples, mais deux canaux principaux existent: l’impact du système financier sur le volume des investissements réalisés (un meilleur système financier diminue le coût du capital et permet de réaliser davantage d’investissements, ce qui augmente la croissance), et son impact sur la qualité de ces investissements (un meilleur système financier permet de réaliser des investissements plus innovants et plus risqués, qui ont un effet stimulant supplémentaire sur la croissance). Les spécialistes d’économie du développement ont en outre souvent insisté sur le rôle de la distribution du patrimoine: dans l’hypothèse où les talents entrepreneuriaux sont également répartis dans la population, l’absence de système financier efficace impose l’autofinancement des projets, et donc l’abandon de tous ceux dont les initiateurs sont trop pauvres. A cette hypothèse favorable à des redistributions patrimoniales (et se recommandant des succès de pays comme Taïwan), certains répondent que si les projets entrepreneuriaux sont d’autant plus innovants et rentables qu’ils exigent des investissements initiaux élevés, ou si les coûts d’intermédiation sont inéluctablement plus élevés pour les petites entreprises, des inégalités de patrimoine peuvent être favorables à la croissance (toujours dans l’hypothèse d’un système financier imparfait en particulier dans son soutien au lancement d’entreprises).
L’impact des structures financières sur la conjoncture, plus précisément le rôle de certaines structures financières dans l’aggravation des crises, est également une idée ancienne, reprise récemment et devenue le centre de nombre de théories modernes des crises conjoncturelles à la suite de la remise en cause des interprétations keynésiennes traditionnelles. Le raisonnement principal repose sur le fait qu’en présence d’asymétries d’information, les prêteurs (déposants envers leurs banques ou banques envers leurs emprunteurs) demandent des garanties. En cas de retournement conjoncturel brutal, la valeur de ces garanties baissant, les banques demandent le remboursement de leurs crédits (tandis que les déposants retirent leur argent), provoquant une fuite vers la qualité et vers la liquidité qui réduit brutalement l’offre de crédit de l’économie et accentue ainsi la crise. Contrairement au mécanisme d’ajustement automatique de la théorie classique qui montre que la baisse des prix des actifs (par exemple des entreprises en bourse) conduit à leur rachat, cette théorie montre que la baisse peut s’entretenir elle-même.
Au total, l’autofinancement apparaît largement en négatif: son retour durant les crises est rendu nécessaire par la disparition des autres moyens de financement et conduit à une mauvaise allocation de l’épargne à l’investissement, et structurellement le développement financier consiste essentiellement à pouvoir s’en passer, même si la plupart des autres modes de financement ont des coûts par rapport au financement direct par l’entrepreneur. Donc l’autofinancement est d’autant plus souhaitable que les capitaux disponibles sont propriété des entrepreneurs, c’est-à-dire que les riches sont entrepreneurs ou les entrepreneurs riches. Au delà des problèmes de distribution de richesse, ceci suggère qu’à système financier donné, l’autofinancement est d’autant moins un obstacle que les opportunités d’investissement sont relativement fortes dans les secteurs déjà florissants, autrement dit que sont importantes les activités à fort savoir-faire dans lesquelles le progrès a lieu par amélioration plus que par des innovations de rupture. La théorie économique a cependant du mal à intégrer ce type d’activité, dont les rendements croissants (résultant de ce savoir-faire) peuvent conduire à un pouvoir de monopole préjudiciable aux intérêts des consommateurs. Elle met davantage l’accent sur les composantes de la croissance qui impliquent le renouvellement des entreprises, et qui suggèrent que le besoin d’intermédiation financière reste important. Dans ce cas, si les profits et donc la capacité d’épargne des entreprises sont concentrés dans les plus anciennes et les plus grandes d’entre elles, le financement de nouvelles entreprises peut être freiné par l’allocation préférentielle de cette épargne à l’autofinancement de projets peu productifs dans les anciennes entreprises, de sorte que l’autofinancement mérite d’être vu plutôt comme un frein. Cependant, les progrès récents de la théorie micro-économique suggèrent qu’une prise en compte plus positive de l’autofinancement est en cours.
2. La théorie micro-économique actuelle: multiplicité des déterminants de la structure financière
La capacité d’autofinancer leur croissance et donc de ne pas dépendre de sources de financement étrangères est clairement de longue date au centre des préoccupations des entrepreneurs. En revanche, la théorie économique ne lui a longtemps accordé qu’une attention limitée (supposant implicitement un marché financier parfait) Si les spécialistes de gestion et quelques économistes (par exemple en France M. Malissen ou R. Courbis) ont dès les années 1950 ou 1960 accordé une grande importance à l’autofinancement, c’est d’abord pour des motifs de politique économique: on se souciait alors, au vu de profits croissant lentement, d’une insuffisance de l’investissement. Les économistes transposèrent le raisonnement des entreprises au niveau de la nation en soulignant les dangers d’une capacité d’autofinancement insuffisante. Mais s’ils ont pu influencer quelque peu les politiques, leurs arguments théoriques n’ont pas convaincu durablement. En effet, ils supposaient que les entreprises avaient une préférence pour certaines formes de financement (l’autofinancement étant préféré à l’endettement, lui-même préféré aux émissions d’actions), mais ne fondaient guère ces préférences en théorie sauf à se référer à la théorie du risque croissant de l’endettement de Kalecki ou à reprendre la thèse de Berle et Means de la préférence pour l’autofinancement résultant de l’indépendance qu’il donne aux dirigeants, toutes théories dont les fondements analytiques ne satisfaisaient plus dans les années 1970. Ce n’est que depuis une quinzaine d’années que la théorie financière a repris l’étude des formes de financement des entreprises, et de ce fait, quoique avec des réticences, reconsidéré la place spécifique à accorder à l’autofinancement. Elle lui a donné des fondements théoriques beaucoup plus stricts, fondés, comme toute la micro-économie, sur l’image du marché parfait et des écarts qui se produisent par rapport à lui.
Si le marché financier était parfait (au sens où y règnerait une concurrence pure et parfaite entre des agents également parfaitement informés et omniscients), le choix d’une structure de financement (d’une répartition entre moyens de financement) serait sans importance, comme le démontre le célèbre théorème de Modigliani et Miller; l’arbitrage des détenteurs de capitaux les amènerait à égaliser les rendements anticipés (et donc les coûts pour l’entreprise) des différents moyens de financement; toute entreprise abandonnerait tous les projets d’investissement dont la rentabilité marginale serait inférieure au taux d’intérêt du marché, et obtiendrait sans difficulté un financement externe pour tout projet à la rentabilité supérieure. En fait, ce théorème est sans application, ou plutôt il sert surtout à mettre en évidence les différentes imperfections du marché financier, c’est-à-dire les multiples raisons de l’existence de préférences de financement et de différences de coûts entre moyens de financement. De fait, chacun de ces derniers présente un ensemble d’avantages et d’inconvénients déterminant des coûts relatifs qui soit amènent à les pondérer dans le choix d’une structure de financement (choisir l’endettement optimal par rapport aux fonds propres), soit les hiérarchisent nettement (auquel cas c’est un rationnement qui peut empêcher d’utiliser uniquement le mode de financement préféré et déterminer la structure de financement). Ces coûts sont fondamentalement des coûts de transaction et d’information, au sens où la théorie économique de l’équilibre général (Arrow-Debreu) montre qu’en situation d’information parfaite et de coûts de transaction nuls les problèmes de financement n’existeraient même pas.
Les choix entre moyens de financement (autofinancement inclus) résultent ainsi de la comparaison de l’ensemble des coûts des uns et des autres. Ces coûts peuvent être soit directement des coûts financiers (le taux d’intérêt d’un emprunt), soit d’autres types (comme la perte potentielle de contrôle ou la nécessité de diffuser des informations stratégiques dans le cas d’émission d’actions). En ce qui concerne l’autofinancement, il n’y a pas de coût financier direct à son utilisation, mais un coût d’opportunité (égal au rendement qui aurait été obtenu par le meilleur usage alternatif possible des profits réinvestis). Il comporte également des avantages et inconvénients non directement financiers (la préservation du contrôle des actionnaires en place, la baisse du risque encouru par les créanciers) qui complètent son coût global , ce qui le rend comparable aux autres modes de financement.
L’origine de ces différences entre les moyens de financement est variable. Certaines peuvent résulter de décisions politiques (comme par exemple des fiscalités différentes), d’autres de la nature des instruments financiers, qui elle-même dépend de l’ensemble du système légal (donc également de décisions politiques, mais comportant une inertie beaucoup plus grande).
Quoi qu’il en soit, considérer sur le même plan l’autofinancement et les diverses formes de financement externe (toujours intermédiées d’une manière ou d’une autre) permet de lui accorder enfin une place positive et non plus seulement une fonction de résidu.
Une analyse plus précise passe par l’examen de la manière dont chaque instrument financier répond relativement aux autres aux diverses fonctions d’un système financier. Levine distingue cinq fonctions principales: faciliter les échanges de biens, services et contrats financiers, mobiliser l’épargne, l’allouer aux investissements les plus rentables, contrôler la gestion des dirigeants et diminuer le risque. Si l’autofinancement est peu concerné par les deux premières fonctions (ce qui constitue une faiblesse potentielle), on peut souligner qu’en matière d’allocation des ressources, son inconvénient évident (il ne peut les allouer aux entreprises nouvelles) est compensé par la qualité de l’information qu’a alors par définition le prêteur sur l’emprunteur, qui sont ici identiques. En revanche, comme le soulignaient déjà Berle et Means, l’autofinancement présente un inconvénient substantiel en matière de contrôle des dirigeants: ne dépendant pas des actionnaires ou de prêteurs pour financer leur entreprise, les dirigeants peuvent développer des projets plus rentables pour eux-mêmes (projets de prestige par exemple) que pour leurs financiers. En matière de risque, l’autofinancement augmente l’actif net et diminue le risque de faillite, ce qui n’est pas pour déplaire aux créanciers. Le risque d’illiquidité qui y est associé pour les actionnaires (propriétaires implicites des actifs autofinancés) dépend de la liquidité des actions. Elle peut donc être comparée à celle d’autres formes de financement.
Une telle approche fonctionnelle montre que l’autofinancement a ainsi des vertus importantes. Elle rétablit l’équilibre par rapport à l’histoire du financement qui est souvent présente à l’état implicite dans les analyses théoriques sur ce sujet, à savoir que l’importance des imperfections du marché financier aurait longtemps imposé aux entreprises de s’autofinancer, et que ce n’est que progressivement que le développement d’institutions financières aurait permis de financer des investissements à partir de ressources extérieures, et donc de se rapprocher du marché financier parfait de la théorie économique.
Elle souligne la multiplicité des causes qui peuvent conduire aux choix de financement, et confirme la difficulté qui existe à passer d’une mesure de l’autofinancement à son interprétation. En particulier, l’importance de l’autofinancement ne peut être interprétée comme la preuve d’un rationnement des capitaux résultant de l’imperfection du système financier qu’à condition de mettre à jour précisément les mécanismes de ce rationnement dans le fonctionnement des banques ou du marché des capitaux. Enfin, il convient de noter que les arguments théoriques qui précèdent supposent une structure économique particulière, dont l’existence historique ne va pas de soi.
B. Questions historiques: quand étudier l’autofinancement ?
L’étude de l’autofinancement des entreprises présente des difficultés conceptuelles et documentaires importantes et en partie liées. L’autofinancement d’une entreprise se définit par l’utilisation pour financer l’investissement de bénéfices non distribués. Identiquement, l’autofinancement correspond au " cash flow " de l’entreprise diminué des impôts payés et des dividendes versés. Cet autofinancement correspond à une ressource pour l’entreprise. Cette ressource est brute au sens où elle inclut les amortissements réalisés et les provisions qui ne sont pas déjà amputées par des pertes effectives. Cette définition " brute " est importante car d’une part l’autofinancement ainsi défini varie moins que l’autofinancement net des amortissements (ce qui limite certaines erreurs de mesure), d’autre part elle facilite des comparaisons dans le temps ou l’espace (étant donné la variabilité de la législation sur les amortissements) ; enfin, dans une économie en croissance, il n’est pas rare que les amortissements comptables dépassent les amortissements économiques, et incluent donc des investissements ; les déduire masquerait donc en partie la réalité.
Cette définition suppose non seulement une claire conception des notions d’investissement et de bénéfices mais aussi leur formalisation explicite dans la comptabilité de l’entreprise. La séparation claire du propriétaire (l’actionnaire) et du dirigeant, la reconnaissance de la personnalité juridique et de l’autonomie financière de l’entreprise par rapport à ses actionnaires en sont des conditions. En effet, en leur absence, le patrimoine de l’entreprise et celui de son propriétaire peuvent être confondus de même qu’investissement de la première et placement du second, tandis que les bénéfices sont difficiles à distinguer des revenus du propriétaire ou apparaissent comme des revenus non consommés. Or on sait que la clarification des concepts comptables a été un processus très lent, et que parce qu’ils répondent aussi à d’autres exigences (notamment fiscales), ces concepts ont toujours été et sont toujours différents des concepts économiques correspondants, de sorte que l’autofinancement reste toujours une mesure dépendante des conventions comptables reçues en un lieu et à une date donnés. Jusqu’aux environs de 1945, ces concepts sont flous ou très différents de ceux acceptés actuellement, ce qui impose à l’historien de reconstruire a posteriori une mesure de l’autofinancement plus ou moins anachronique et plus ou moins adaptée aux circonstances particulières.
Au niveau macro-économique, un problème classique d’agrégation prend ici une dimension particulière. En effet, la caractérisation d’une économie en termes d’autofinancement demande de disposer non seulement du niveau de l’autofinancement moyen mais aussi de la distribution des taux d’autofinancement individuels des différentes entreprises. En effet, un même taux global d’autofinancement de 100% peut correspondre à une économie où toutes les entreprises s’autofinancent entièrement, et où donc aucun intermédiaire ni marché financier ne contribue au financement, ou à une économie où coexistent des entreprises en excédant de ressources (autofinancement supérieur à 100%, correspondant à l’accumulation d’actifs financiers par ces entreprises) et d’autres ayant des besoins de financement, économie dans laquelle les flux financiers entre entreprises, à travers le marché financier ou non, peuvent être importants. Un niveau global de l’autofinancement n’est donc pas seulement une moyenne, mais aussi un indicateur en soi des formes de flux financiers qui peuvent exister dans une économie.
La plupart des progrès réalisés depuis une quinzaine d’années en matière d’étude des structures financières ont fait ressortir la complexité des causalités enchevêtrées dans la détermination micro-économique de l’autofinancement. Il en résulte que la compréhension de l’autofinancement au niveau macro-économique est encore plus difficile, et moins avancée. En termes de politique économique, on continue de se soucier d’une baisse trop forte de l’autofinancement global, mais c’est sans fondement assuré.
Surtout, parler d’autofinancement au niveau macro-économique suppose en pratique une économie dominée par des entreprises pour lesquelles le concept d’autofinancement ait un sens. En effet, seules de véritables sociétés (par opposition aux entreprises individuelles) ont réellement recours aux formes de financement externes auxquelles s’oppose l’autofinancement. Le caractère principalement formel du financement (par opposition au crédit interpersonnel, même notarié, absent presque nécessairement des statistiques) est donc une condition empiriquement nécessaire à la mesure agrégée du financement externe et donc de l’autofinancement.
Si l’on part du cas des entreprises individuelles, qui représentent une part substantielle de l’activité économique jusque tard dans l’histoire économique française, on comprend mieux les difficultés qui se présentent, spécialement pour une étude de l’autofinancement au niveau national. Ces entreprises comportent un nombre d’associés variable, dont certains apportent seulement du financement mais apparaissent comme dirigeants; l’existence par exemple de substitutions entre générations lors des transmissions d’entreprise montrent que l’on peut jouer sur des formes multiples de financement externe, sans que la séparation entre autofinancement et financement externe soit toujours très claire de même que la séparation entre épargne familiale et épargne de l’entreprise. Du fait qu’on ne commence à mesurer une forme d’autofinancement pour les petites entreprises de type familial que lorsque leur financement externe se formalise (ce qui va avec la formalisation de leur comptabilité financière interne), les approches macro-économiques de l’autofinancement y incluent presque nécessairement les formes informelles de financement (qui, selon la pauvreté des statistiques, peuvent inclure même des obligations émises sur un marché étroit non recensé, ou des crédits à long terme de banques non observés). En un sens donc, les statistiques macro-économiques sur l’autofinancement, qui le mesurent par la différence entre un investissement global lui même calculé au niveau macro-économique (la production de biens d’investissement) et les montants obtenus par des moyens de financement externe formels et bien mesurés (longtemps essentiellement les émissions de titres) montrent le degré de formalisation du financement de l’économie et la qualité des systèmes statistiques autant que le degré auquel les entreprises financent leurs investissements par leurs profits.
Le sens de l’autofinancement se modifie aussi, mais différemment, lorsque l’on passe de sociétés privées à des entreprises publiques ou quasi-publiques, pour lesquelles le risque de faillite est considéré comme nul par le marché financier ce qui les autorise à un endettement élevé, ou lorsque l’on prend en compte les situations de concurrence imparfaite. Dans le premier cas, les possibilités indéfinies d’endettement interdisent d’interpréter l’autofinancement de ces sociétés en terme de contrainte sur l’investissement. Il est une ressource, non nécessaire puisque remplaçable aisément, et potentiellement mal utilisée si son abondance conduit à des investissements peu rentables.
Concernant la situation de monopole, elle influence potentiellement l’autofinancement. En effet, en concurrence parfaite, comme l’entreprise ne peut pas fixer un prix différent de celui de ses concurrents, sa marge est déterminée entièrement par ses coûts. Dans ce cas, on peut s’attendre à une corrélation entre un investissement élevé (résultant d’une efficacité élevée) et un profit élevé (aux causes identiques), sans que l’autofinancement soit nécessairement important pour autant (même si les bénéfices sont retenus). En concurrence imparfaite, une entreprise possède un pouvoir de marché, et donc n’est pas purement preneuse de prix. Dès lors, si elle agit selon une logique de profit maximal, elle choisit entre davantage de profit par unité vendue et davantage d’unités vendues (sur une période incluant présent et futur). Choisir de vendre moins d’unités à prix élevé conduit à des besoins moindre en termes de capacités, donc à un moindre investissement et donc à un autofinancement plus élevé par rapport au choix de prix bas et de développement de capacités. Le taux d’autofinancement doit selon cette logique être fonction décroissante de l’élasticité-prix de la demande dans la mesure où plus la demande est inélastique, plus on peut augmenter les prix en restreignant la production, et donc augmenter les profits en diminuant l’investissement. Selon la même théorie, une entreprise publique maximisant le bien-être social est conduite dans le cas de monopole naturel (rendements d’échelle croissants) à vendre une quantité importante à bas prix, recevant en compensation une subvention d’exploitation de l’Etat. Son autofinancement est alors faible voire négatif sans que cela ne remette en cause son éventuelle efficacité.
On voit aisément qu’au niveau de l’ensemble de
l’économie, le taux d’autofinancement sera fortement influencé
par la transformation de la structure productive, en particulier par l’évolution
des parts dans la production des entreprises individuelles, des sociétés
accédant aux financements formels publics et des entreprises publiques,
mais sans doute également (et de manière liée) par
l’évolution des poids de différents secteurs accédant
inégalement aux formes de financement que nous avons décrites.
Enfin, les formes de la concentration et des liens entre entreprises joueront
aussi un rôle substantiel. Malgré ces grandes difficultés,
c’est cette évolution macro-économique de l’autofinancement
que nous voudrions maintenant, au moins à titre de cadrage sommaire,
tenter de fournir.
II.
L’autofinancement depuis 1914: une tentative de cadrage macro-économique
Si la plupart des théories de l’autofinancement présentée ci-dessus sont essentiellement microéconomiques, il n’en est pas moins utile de tenter une évaluation globale du rôle de l’autofinancement dans l’économie française, qui permet de situer les études microéconomiques par rapport à un ensemble plus général et qui permet d’envisager des questions proprement macroéconomiques (soit, comme envisagé ci-dessus, le rôle des formes de financement dans la croissance, les fluctuations ou les inégalités).
La mesure du niveau macroéconomique de l’autofinancement au XIXe siècle est victime de l’ensemble des difficultés présentées ci-dessus. Les transformations rapides de la structure sectorielle de l’économie, celles des formes juridiques d’entreprises et les changements organisationnels qui ont lieu durant le siècle la rendent difficile et peut-être peu significative. L’économie française du XIXe siècle juxtapose des PME industrielles et commerciales largement autofinancées sauf à court terme, et de grandes entreprises qui maintiennent durablement les pratiques des PME, sauf dans un nombre restreint mais croissant de secteurs recourant au marché financier: canaux et chemins de fer d’abord, compagnies de distribution d’eau, de gaz puis d’électricité ensuite, banques à réseaux, tramways, enfin mais marginalement sociétés immobilières. Les entreprises proprement industrielles ne commencent à recourir que très tard à d’autres formes de financement que le crédit commercial à court terme ou le financement à long terme auprès de réseaux proches des associés. Les changements structurels de l’économie et donc des parts de ces différents types d’entreprises importent autant que les changements de financement caractérisant chaque type pour l’évolution macroéconomique du financement. Ils n’en sont d’ailleurs pas indépendants puisque l’existence de contraintes différentielles de financement contribue certainement aux choix de formes sociales des entrepreneurs ou au développement relatif des différents secteurs.
L’évolution macroéconomique présentée ci-après est donc de toute évidence très schématique et les interprétations proposées sont clairement suggérées plus que démontrées.
La seule véritable étude synthétique sur les parts des différentes formes de financement au XIXe siècle est celle de Teneul, qui comporte des défauts substantiels résultant de sa conviction d’un développement continu du financement externe et d’un déclin corrélatif de l’autofinancement. En fait, P. Verley montre bien que le rôle de l’autofinancement est, très logiquement, fortement corrélé dans le temps avec la part dans l’investissement des secteurs économiques dans lesquels le recours au financement externe était difficile. Ainsi, le financement externe est important dès le milieu du siècle à cause des chemins de fer, et le redevient à la fin du siècle sous l’impulsion de l’électricité ou des tramways. Cette perspective confirme la nécessité d’ancrer le raisonnement macroéconomique dans une connaissance fine des transformations de l’économie et des conditions de financement des différents secteurs, qui rendent nécessaires et complémentaires les études microéconomiques.
Quel que soit l’intérêt manifeste de ces tentatives, elles restent nécessairement très hypothétiques du fait du caractère très lacunaire des données statistiques à la fin du XIXe siècle. Le XXe siècle présente des particularités qui donnent un sens spécialement important à l’analyse proprement macroéconomique (et qui compensent une disponibilité d’information guère meilleure, au moins avant 1945). C’est pourquoi nous avons concentré notre étude sur ce siècle, sans que cela nous dispense de tenter de relier niveaux macro et microéconomique que la théorie et l’exemple du XIXe siècle nous suggèrent.
A. Problèmes de données
Les données financières sont parmi les pires qui existent avant les années 1950 au niveau macro-économique. L’analyse qui est proposée par P. Villa sur ce point est sans ambiguïté. Il montre en effet comment il est difficile de réaliser une évaluation de l’épargne brute des sociétés qui réconcilie les travaux réalisés par Malissen à partir des statistiques fiscales (les 50.000 plus gros déclarants aux bénéfices industriels et commerciaux) et bilantielles pour 1921-1949, ceux construits par Marquis à partir d’un échantillon réduit de 90 sociétés pour 1930-1938 (dont on ne sait pas d’ailleurs si les bénéfices cités sont bruts ou nets des amortissements) et d’une méthode d’extrapolation basée sur les statistiques fiscales sur les dividendes, ou ceux enfin de Teneul, qui reprend et modifie les deux précédentes. Villa reprend Marquis en supposant qu’il fournit des indicateurs de profits nets (car les chiffres absolus sont trop faibles par rapport à ce qui peut être envisagé d’après les comptes nationaux) et en le complétant donc (outre des corrections marginales) par une estimation économique (et non comptable) de l’amortissement, déduit de sa propre estimation du stock de capital. Il suppose en outre que la part du stock de capital détenu par les entrepreneurs individuels est constante, ce qui d’ailleurs présente l’inconvénient d’interdire les explications en termes de changement de structure (au moins de taille des entreprises). On comprend certes les réticences de Villa envers Teneul, qui corrige les données de Malissen (cf. pp. 122-123) pour aboutir à des ordres de grandeur plus cohérents avec le reste de la comptabilité nationale, mais modifie arbitrairement et de manière assez peu convainquante la part de l’autofinancement au cours de cette correction. Mais la préférence accordée à Marquis malgré son petit échantillon n’est pas entièrement satisfaisante, ce qui nous conduira à reproduire également les chiffres de Malissen.
Après 1949, quand un minimum de données redeviennent disponibles, plusieurs évolutions économiques rendent difficile le maintien d’une mesure homogène de l’autofinancement sur longue période. Les erreurs qui subsistent sont cependant de deuxième ordre par rapport à l’incertitude qui règne avant 1939. En premier lieu, le développement des prises de participations entre entreprises pose un problème de cohérence entre données individuelles et données macroéconomiques d’autofinancement. Les études sur données individuelles tendent à considérer les crédits à long terme et les prises de participations comme des investissements, alors que la comptabilité nationale n’inclue dans la FBCF que la variation des immobilisations fixes. Pourtant, les immobilisations financières peuvent être considérées comme aussi nécessaires au développement des entreprises, et dans une large mesure comme le substitut des immobilisations matérielles. Il résulte des hypothèses de la comptabilité nationale que le choix par une entreprise entre développer une activité en son sein ou à travers une filiale peut affecter le niveau de l’autofinancement (en particulier il modifie certainement l’autofinancement des catégories d’entreprises prises séparément). Deuxième difficulté, plus mineure: le développement du crédit-bail et de la location de longue durée avec option d’achat est masqué dans la base comptabilité nationale de 1971 qui considère les biens d’investissement correspondants comme achetés par le bailleur (une entreprise financière en général), et les flux financiers comme la rémunération d’une prestation de service, ce qui minore les investissements des entreprises non financières et leurs dettes. Ceci est modifié dans la base 1980 qui les considère comme des investissements des entreprises utilisatrices financées par un crédit. Au total, les incertitudes de méthode comptable posent encore des difficultés et créent des ruptures de séries depuis 1949, mais laissent un résultat relativement solide. Les défauts principaux des séries récentes ne sont pas dans leur précision, mais dans leur interprétation: tout d’abord la période d’inflation soutenue a détériorée le sens de nombre d’indicateurs financiers et rendu souhaitable un examen des bilans en termes de stocks (d’actifs et de passifs) et non de flux (émissions, autofinancement, investissement). D’autre part, on regrette que l’analyse des transformations à long terme soit freiné par l’absence avant 1980 de comptes financiers par branche, ce qui freine le développement d’interprétations en termes de transformations structurelles.
B. Le niveau global de l’autofinancement: quelques évolutions et comparaison internationale
1. Evolution du niveau global de l’autofinancement en France
L’entre-deux-guerres
Si elles fournissent uniquement une évaluation des bénéfices retenus (et n’incluent donc pas l’amortissement) les données de Malissen sont cependant assez correctement construites pour mériter l’examen. Ces principaux résultats sont repris dans les graphiques 1 et 2.
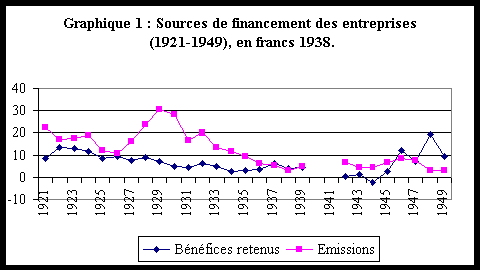
Source: Malissen, op. cit.
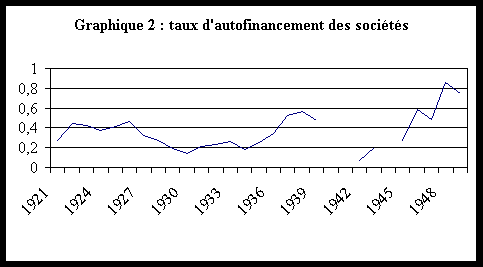
Source: M. Malissen, op. cit.
Le taux d’autofinancement de Malissen n’est pas construit
à partir de données sur l’investissement, mais simplement
en rapportant les bénéfices retenus à la totalité
des ressources financières, à savoir la somme de ces bénéfices
et des émissions de titres (qui sont reprises des statistiques réalisées
par le Crédit lyonnais).
Le niveau des bénéfices retenus (et donc
de l’autofinancement) ainsi construits est nécessairement bas en
moyenne du fait de l’exclusion des amortissements. On aimerait l’interpréter
en fonction du taux d’investissement prévalant durant cette période.
Malheureusement, du fait de l’instabilité de l’entre-deux-guerres,
il est difficile de comparer les valeurs de l’investissement proposées
pour les années 1920 à celui de périodes plus stables.
La faible croissance des bénéfices entre 1927 et 1930 semble
relativement étonnante ; elle suggère que l’envolée
de l’investissement de cette période a été financée
essentiellement par les émissions massives de titres qui ont lieu
de 1927 à 1931. En effet, si les travaux actuels tendent à
souligner la faiblesse des profits réels des entreprises durant
la période inflationniste, renforcée par la sévérité
du fisc refusant jusqu’à 1926 de corriger les amortissements pour
tenir compte de l’inflation et freinant la concentration de l’industrie,
ils sont plus optimistes pour la fin des années 1920.
On pourrait s’étonner de voir l’autofinancement, c’est-à-dire ici le montant des bénéfices retenus par rapport aux émissions, rester relativement élevé dans les années 1930. L’auteur souligne justement dans ses commentaires que les sociétés ont continué de déclarer des bénéfices de manière à pouvoir distribuer des dividendes et faire bonne figure vis-à-vis des créanciers comme des actionnaires, mais que la distribution de ces profits apparents a même renforcé le désinvestissement considérable qui, bien qu’il n’apparaisse pas dans les bilans, est bien une réalité de l’industrie française durant les années 1930.
Malissen conclut aussi à une tendance à l’augmentation de la rétention des profits, qu’il explique en particulier par l’augmentation de la taxation des bénéfices distribués (à l’impôt sur le revenu): les gros actionnaires, frappés par des taux d’imposition élevés sur des dividendes qu’ils comptent de toute façon placer en valeurs mobilières (et non consommer), préfèrent laisser les bénéfices dans l’entreprise et revendre leurs actions en cas de besoin de liquidité (p.200). Cette affirmation, si conforme à la mentalité anti-fiscale française mais aussi aux enseignements de la théorie financière (la fiscalité frappant inégalement les différentes formes de financement fait partie des premières raisons de distinguer entre elles identifiées par cette théorie) n’est cependant pas aisée à vérifier plus précisément, et il semble que le choix entre formes de financement soit influencé de manière prépondérante par d’autres facteurs que la fiscalité.
Selon les données construites sur le modèle de la comptabilité nationale par Villa, l’autofinancement augmente presque continument durant l’entre-deux-guerres (cf. graphique 3).
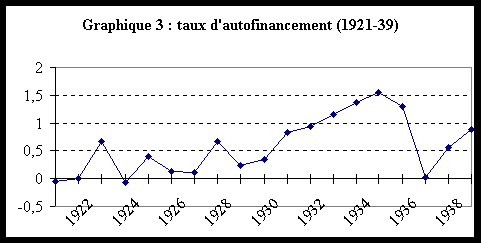
Source: Villa, op.cit.
La contradiction avec les travaux de Malissen n’est en partie qu’apparente. Villa en effet ajoute les amortissements qui, représentant un montant plus élevé (du fait d’un stock de capital accru) durant la seconde partie des années 1920, pèsent plus lourd au regard des autres ressources financières ; le taux d’autofinancement diminue d’ailleurs chez lui aussi du fait de l’impact mécanique des émissions massives des années 1928-30. Par la suite, Villa ne retient pas l’hypothèse pourtant probable d’une baisse des dépenses d’entretien du capital effectuées dans les années 1930, ce qui le conduit à des taux d’autofinancement très élevés par surestimation de la capacité d’autofinancement (amortissements hypothétiques inclus) tandis que son investissement mesuré au niveau macro-économique s’effondre bel et bien. Il reste difficile de croire que les entreprises françaises dégagent une capacité de financement durant les pires années de la crise.
Quoi qu’il en soit, l’entre-deux-guerres est clairement marqué par une caractéristique principale en matière d’investissement: l’importance des facteurs macro-économiques s’imposant à la masse des entreprises, qu’il s’agisse de l’inflation, de la fiscalité ou de la crise. Ceci conduit à des évolutions très fortes des structures de financement, qui suggèrent la présence de rationnements importants à certaines périodes. Dans les années 1920 pour les entreprises ne pouvant accéder au marché financier ; dans les années 1930 pour la plupart des entreprises du secteur exposé, incapables de dégager les ressources nécessaires au simple maintien en l’état de leur équipement.
Après 1945
Les années de guerre et d’immédiat après-guerre ne sont pas couvertes par la Comptabilité nationale, qui ne fait débuter ses séries qu’en 1949. Le travail de Malissen permet cependant un examen de cette période (cf les graphiques ci-dessus). Il souligne la remontée des profits et des investissements dès la Libération: en l’absence de possibilité de recours important au marché financier pour les sociétés privées, l’autofinancement était alors nécessairement très élevé. Il est cependant probable que la hausse des profits, dont le graphique laisse mesurer le caractère à la fois tardif et limité, n’a pas été sans laisser des occasions d’investissement inexploitées faute de ressources financières.
On a vu que les données proposées par la Comptabilité nationale après 1949 sont d’une qualité sans commune mesure par rapport aux chiffres antérieurs. Cependant, elles ne permettent pas aisément de dégager des lignes de force claires. Les chiffres bruts de l’INSEE indiquent un autofinancement très fluctuant mais stable à long terme entre 1949 et 1973 (cf. graphique 4). Les données de Villa, qui a tenté de reconstituer une série homogène sur l’ensemble de la période, indiquent cependant une nette diminution en début de période, suivie d’une stabilité voire d’une hausse dans les années 1960. On notera qu’une telle baisse initiale ne serait pas surprenante dans le contexte de rapide croissance de l’investissement qui a lieu durant cette période (avec l’encouragement de l’Etat par le Plan et par des avantages fiscaux), tandis que la stabilité postérieure peut sans doute s’expliquer partiellement par la volonté des pouvoirs publics (par exemple dans le Ve Plan) de soutenir l’autofinancement considéré, sous l’influence de personnalités comme M. Malissen et R. Courbis, comme une condition essentielle du dynamisme de l’investissement. Cette volonté se traduit par une baisse des prélèvements pesant sur les entreprises.
Pour la période suivante, les deux séries s’accordent sur les traits principaux de l’évolution de l’autofinancement: une forte baisse dans les années 1970 suivie d’une reprise rapide après le changement de politique économique de 1983. Selon un paradoxe qui n’est qu’apparent, le développement du marché financier qui a lieu alors se conjugue avec une forte augmentation de l’autofinancement. En réalité, l’économie française traverse après 1983 quelques années d’investissement très faible, ce qui contribue à une remontée de l’autofinancement. Celui-ci diminue quelque peu après 1986, mais reste plus élevé.
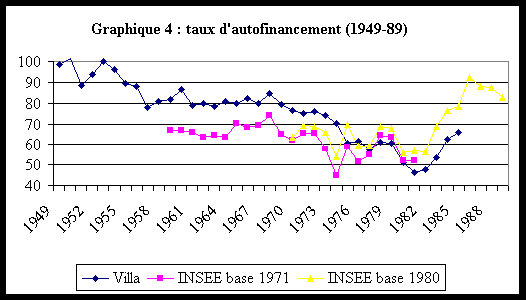
Sources: INSEE et P. Villa, op. cit.
Cette première explication associant le rythme de l’investissement à l’autofinancement suppose une capacité d’autofinancement qui croît de manière retardée par rapport à l’investissement. Il semble en effet que, sauf à voir l’endettement augmenter à l’infini, les deux doivent croître à long terme à des rythmes similaires. Dans les années 1960, période de prix relativement stables, c’est nécessairement le cas ; par la suite, il est clair que l’inflation a pu permettre un temps de masquer un écart entre ces deux rythmes: l’endettement à des taux réels qui s’avéraient a posteriori très faible a pu dans les années 1970 augmenter sans menacer la structure de bilan des entreprises. Le réveil n’en est que plus douloureux après 1983, quand la décrue de l’inflation rend cette dette lourde, ce qui rend tout financement externe difficile et impose une hausse de l’autofinancement comme une baisse de l’investissement.
Il n’est pas sûr cependant que cette explication conjoncturelle suffise, même pour les années 1970. En effet, il faut sans doute lui associer les changements dans le partage de la valeur ajoutée pour bien comprendre la rupture qui sépare les années 1970 des deux décennies antérieures. Les années 1960 et 1970 voient en effet une diminution progressive de la part d’abord de l’Etat puis des profits dans la valeur ajoutée au profit de celle des salaires, qui s’explique en partie par des caractéristiques structurelles de l’économie française: épuisement des ressources abondantes de main d’œuvre offertes par l’exode rural, tensions sur le marché du travail, à quoi s’ajoutent des chocs comme la crise de 1968. Après avoir choisi de financer par l’endettement le maintien de sa croissance dans les années 1970, la France doit modifier sa stratégie au début des années 1980 quand les taux d’intérêt nominaux et réels s’élèvent. La capacité d’autofinancement des entreprises s’élève alors grâce à une remontée de la part des profits dans la valeur ajoutée, elle même résultat d’un chômage élevé qui diminue la capacité de revendication salariale et d’une libéralisation des flux de capitaux qui impose de fournir aux capitalistes français des rendements similaires à ceux qu’ils obtiendraient à l’étranger. Le développement du marché boursier n’est donc pas dans ce contexte celui d’un substitut au financement bancaire, mais d’un complément à un taux d’autofinancement élevé, permettant de ré-allouer entre les entreprises des capitaux essentiellement épargnés par elles.
2. Comparaison internationale des niveaux d’autofinancement
Une brève comparaison internationale permet d’éclairer les liens entre la structure du système financier et son rôle macro-économique comme les particularités de l’autofinancement en France. Elle pourrait fournir une base empirique aux travaux théoriques mentionnés précédemment qui s’éloignent de la recherche d’une structure financière optimale universelle pour reconnaître sa relativité aux circonstances particulières, dont les nations pourraient constituer des exemples. On connaît en effet l’opposition classique entre le rôle des banques en Allemagne et celui des marchés aux Etats-Unis. Une comparaison internationale précise des structures de financement ne peut toutefois pas se réduire à cette opposition, et présente des difficultés conceptuelles et statistiques particulièrement grandes. Parmi les difficultés statistiques à surmonter, celles concernant les définitions de l’autofinancement sont importantes: selon les pays, sont inclus ou non dans les bénéfices non distribués diverses provisions, subventions, plus-values exceptionnelles, etc.
Cependant, certains auteurs s’y appliquèrent dès les années 1960. Ainsi, dans une étude publiée en 1968, L. Joerger montrait, à partir de données de comptabilité nationale, que le taux d’autofinancement moyen entre 1960 et 1966 était de 104 aux Etats-Unis, 129 en Grande-Bretagne, 78 en Allemagne, 74 au Japon et 67en France (des études sur échantillons de firmes donnaient 99 en Grande-Bretagne, 77 en Allemagne, 58 au Japon et 95 en France, donc des résultats très différents, mais qui s’expliquaient partiellement par les échantillons assez restreints et souvent limités aux grandes entreprises). Des recherches plus détaillées menées par ce que l’on a appelé l’école de la Banque de France puis dans le cadre de l’OCDE dans les années 1980 aboutirent à des résultats similaires, proposant par exemple des taux moyens d’autofinancement entre 1974 et 1982 de 92,2 aux Etats-Unis, 96,2 en Allemagne, 60,3 au Japon et 59% en France. Dans tous les cas Grande-Bretagne et Etats-Unis ont des taux élevés, France et Japon des taux bas, tandis que l’Allemagne passe d’une catégorie à l’autre en particulier en fonction du traitement des fonds de retraites accumulés au sein des entreprises.
On a vu ci-dessus qu’une intuition fréquente associe une baisse de l’autofinancement au développement d’un marché financier plus efficace, en supposant que l’autofinancement résulte d’abord de l’existence d’imperfections de marché. Comme il semble difficile d’accuser la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis d’être dotés de systèmes financiers sous-développés, il est nécessaire de trouver d’autres interprétations au niveau élevé d’autofinancement qui y règne.
On pourrait envisager d’abord que les différences de taux d’autofinancement puissent être essentiellement conjoncturelles, résultant des différences de taux de croissance de l’investissement entre pays. En effet, à capacité d’autofinancement donnée, un investissement plus élevé correspond à un taux d’autofinancement plus bas. Cependant, un calcul rapide montre aisément que même supposer un taux de croissance de l’investissement identique dans tous les pays et des capacités d’autofinancement inchangées ne modifierait pas radicalement la hiérarchie internationale des taux d’autofinancement.
Une explication inverse, soutenue par certains auteurs keynésiens, consiste à dire qu’un système financier centré autour de banques peut stimuler l’investissement en "avançant" par création monétaire les fonds nécessaires, fonds qui sont remboursés par la richesse créée par ces investissements mêmes. Le rôle des banques dans le crédit aux entreprises expliquerait ainsi les taux de croissance plus élevés de l’Allemagne, du Japon ou de la France durant les Trente glorieuses. L’importance des marchés dans les pays anglo-saxons aurait empêché la création de banques suffisamment proches des entreprises pour jouer ce rôle. Cette explication présente certaines difficultés, parmi lesquelles tout d’abord la disparition depuis les années 1980 de la supériorité en termes de croissance rapide des pays "de banques" (disparition un peu plus tardive au Japon, mais la crise bancaire et économique qui y sévit depuis 1990 suggère que ce système a des inconvénients à la hauteur de ces avantages). Elle peut au mieux se maintenir dans le cadre d’une logique à la Gershenkron, c’est-à-dire dans laquelle le système financier optimal pour un pays dépend en partie de la situation économique relative de ce pays par rapport aux autres. Le crédit bancaire des années 1960 et 1970 n’aurait pu donner de bons résultats que dans les pays en retard technologique, dans lesquels la simplicité des choix d’investissement (largement imités des pays les plus avancés) aurait donné un avantage comparatif aux banques et réduit l’intérêt des talents de sélection d’innovation qu’auraient les marchés financiers. Le rattrapage par ces pays de leur retard verrait la disparition de cette supériorité des systèmes centrés sur les banques.
Une telle piste mérite sans doute d’être élargie et précisée. On peut penser en particulier que les systèmes financiers doivent dans une certaine mesure être adaptés aux spécificités de chaque pays, même si des contraintes difficiles à modifier demeurent et limitent l’espace des choix possibles en la matière. Ainsi, des travaux récents ont montré le poids des différences de régimes juridiques (protection des actionnaires minoritaires, facilité et vitesse de liquidation en cas de faillites, toutes structurellement peu développées dans les pays de tradition juridique française et à un moindre degré allemande) tandis que d’autres insistent sur l’adaptation des systèmes financiers aux besoins des différents secteurs d’activité et donc à des structures économiques différentes selon les pays.
Toutes ces études supposent qu’à conditions
données les structures de financement résultent d’un choix
optimal ; elles supposent l’absence d’influences entre systèmes
financiers nationaux, hypothèse nécessaire à leur
méthode de comparaison internationale à un instant donné.
Seule une approche historique peut tenir compte des interdépendances
existant lors de leur constitution et durant leur évolution entre
les différents systèmes financiers nationaux. Cette étude
est cependant encore balbutiante: par exemple, si l’on devine que l’ouverture
des économies et surtout la globalisation financière ont
sans doute contribué à une convergence vers le système
financier américain depuis les années 1980, il ne s’agit
que d’hypothèses, et l’on ne saurait y réduire un phénomène
sans doute complexe et de plus longue haleine.
III. Du macro au micro-économique (et retour): pour une analyse globale de l’autofinancement.
On a proposé ci-dessus un certain nombre d’explications macro-économiques des principales évolutions de l’autofinancement en France depuis 1914. On a également vu qu’une comparaison internationale remet en cause ces explications, en soulignant les différences durables qui existent entre pays soumis à des conjonctures macro-économiques similaires.
Une des explications possibles à cette difficulté consiste à redescendre des données macro-économiques à leurs constituants, pour envisager, comme nous l’avons déjà suggéré, les transformations de la structure productive qui ont pu peser sur l’évolution globale de l’autofinancement. Parmi ces transformations, les plus importantes en France sont jusqu’à 1945 les changements de formes sociales des entreprises (qui permettent souvent des changements de formes de financement), après 1945 le poids des sociétés publiques, et en permanence les changements dans l’importance des différents secteurs de l’économie.
Nous ne pourrons traiter ici de l’ensemble de ces transformations, mais quelques considérations liminaires suivies d’un exemple analysé en détail permettront d’indiquer l’importance de cette approche.
De même que l’on a vu ci-dessus les différences de comportements que l’on doit envisager entre entreprises de formes sociales différentes, il y a tout lieu de penser que les différents secteurs d’une économie ont des comportements financiers différents. On peut ainsi s’attendre à un taux d’autofinancement faible lors du démarrage d’un secteur où sont nécessaires des investissements initiaux importants, et à un taux d’autofinancement élevé (voire supérieur à 100%) lorsque le secteur est mûr et les investissements réduits essentiellement à l’entretien (canaux, réseaux de chemins de fer ou de transport d’eau ou d’énergie). Certes, il peut y avoir des exceptions, soit quand la croissance résulte d’une technologie neuve qui procure des rentes de monopole si élevées qu’elles permettent très vite de financer même un développement rapide, soit à l’inverse lorsque les bénéfices attendus ne sont pas au rendez-vous à la maturité (du fait de la concurrence d’autres secteurs ou de contraintes publiques sur la tarification). Certains secteurs sont par ailleurs plus en mesure que d’autres de recourir au financement externe: soit que la stabilité connue de ces activités rassure l’investisseur, soit qu’ils puissent fournir des garanties sous forme d’actifs aisément évaluables et liquidables (immeubles, terrains, actifs réutilisables à d’autres fins). Le simple fait que des observateurs extérieurs à l’entreprise soient capables de mesurer son activité et de se faire une idée par eux-mêmes de son succès constitue une forme de contrôle des dirigeants propre à faciliter leur recours à l’endettement ou à l’émission d’actions: il est clair que la multiplication des publications et des statistiques disponibles sur les chemins de fer au XIXe siècle n’a pas été étrangère au succès de leurs émissions: selon les termes de l’époque, la meilleure propagande est la publicité. Enfin, le fait que l’Etat ait en France (et ailleurs) garanti (parfois implicitement) un certain nombre de dettes privées a naturellement eu un rôle important dans le financement des secteurs concernés, avant même les nationalisations qui ont finalement conclu la plupart de ces expériences.
Ces différents arguments ont sans doute tous une part de validité ; il conviendrait cependant de mesurer lesquels pèsent le plus à chaque époque, et donc dans quelle mesure certains secteurs sont contraints à l’autofinancement. D’autres arguments devraient être envisagés du côté de la rentabilité relative des différents secteurs, et donc de la dynamique autonome de la capacité d’autofinancement. Ceci impliquerait une analyse des formes de la concurrence selon les marchés qui est peu avancée sauf dans la période récente. Nous ne pourrons ici comparer et pondérer les poids de tous ces arguments, et chercherons seulement à examiner la dynamique de la structure industrielle française dans l’entre-deux-guerres et à en tirer quelques conséquences en matière d’autofinancement.
Pour mener cette analyse en l’absence de données financières de comptabilité nationale (même rétrospective) au niveau des secteurs, et pour observer au moins partiellement la dispersion des taux d’autofinancement entre entreprises, nous avons étudié les formes de financement des entreprises cotées en Bourse durant l’entre-deux-guerres. Considérant les sources comptables comme peu fiables dans une période de fortes variations de prix, nous avons utilisé dans un travail antérieur une base de données sur l’ensemble des opérations financières des entreprises françaises cotées au marché officiel parisien (soit un peu plus de 1000 sociétés) et quelques hypothèses tirées de la théorie financière contemporaine pour calculer des taux d’autofinancement durant plusieurs sous-périodes. Le tableau 1 mesure la part moyenne de l’autofinancement dans le financement de l’investissement des entreprises cotées pour les deux périodes de forte croissance situées de part et d’autre de la première guerre mondiale.
Les principaux résultats que l’on peut tirer de ce tableau sont les suivants:
Tout d’abord, au niveau d’ensemble, ce tableau montre une diminution sensible du rôle de l’autofinancement après 1914 (la part du financement externe double presque). Naturellement, ce comportement ne concerne que les sociétés cotées, et on peut penser que les sociétés non cotées ont beaucoup plus de mal à obtenir des financements externes. Cependant, la diminution du rôle de l’autofinancement peut sans doute être étendue à l’ensemble de l’économie car le nombre des sociétés cotées et leur part dans l’économie augmentent fortement, ce qui renforce mécaniquement l’effet du comportement de ces sociétés. Le poids de leurs émissions de titres passe ainsi de 6,4% de l’investissement des entreprises (tel que mesuré par Villa) entre 1901 et 1913 à 9,5% entre 1914 et 1928.
Tableau 1: part de l’autofinancement dans le financement des entreprises cotées
| secteurs |
|
|
|
|
|
| Services |
|
|
Ki < 5 |
|
|
| Transports |
|
|
5 à 10 |
|
|
| Biens de consommation |
|
|
10 à 25 |
|
|
| Biens d’investissement |
|
|
25 à 50 |
|
|
| Biens intermédiaires |
|
|
50 à 100 |
|
|
| Énergie |
|
|
100 à 200 |
|
|
| 200 à 500 |
|
|
|||
| Total |
|
|
>=500 |
|
Légende: l’autofinancement est la part de la croissance de l’actif des entreprises qui ne s’explique pas par les émissions de titres ou les apports en nature (selon la méthode expliquée dans Hautcoeur, " Le financement… ", op.cit.). La deuxième partie du tableau fournit l’autofinancement selon la taille des entreprises, mesurée par leur capitalisation boursière (Ki) au début de la période en question, mesurée en millions de francs 1913 (avant 1914, il y a en fait une société, la Banque de France, de taille supérieure à 500 millions; nous l’avons comptée avec celles de la catégorie précédente).
Source: Hautcoeur, Le marché boursier…, op. cit., pp. 94-95 (qui donne des chiffres plus détaillés pour 26 secteurs).
Le secteur d’appartenance des sociétés semble avoir un impact beaucoup plus important que leur taille sur leurs formes de financement, et en particulier sur le rôle de l’autofinancement. On peut donc penser que la transformation sectorielle de l’économie joue un rôle important dans les variations du taux d’autofinancement global. Ainsi, on voit successivement apparaître en Bourse puis émettre des titres (souvent avec un décalage de 15 ans entre les deux opérations) des secteurs nouveaux, caractéristiques de ce qu’on a appelé la seconde industrialisation: chimie, mécanique, cinéma, alimentation, grands magasins, et bien sûr avant tout l’électricité. Le renouvellement de la cote de la Bourse tend donc d’abord à abaisser l’autofinancement de secteurs auparavant incapables d’émettre des titres (au moins au delà d’un cercle restreint) ; selon des rythmes qui varient en fonction de la structure du secteur (dans l’alimentation, les marques fournissent des pouvoirs de monopoles et donc des profits élevés qui rendent parfois inutile le recours au financement externe) et des besoins d’investissement (les besoins initiaux sont considérables pour la distribution d’électricité, pas pour la chimie ou l’alimentation).
Les événements nationaux demeurent importants: les taux d’autofinancement des secteurs traditionnels, qui soit dégageaient des excédents de financement (textile, houillère) soit avaient un passé de gros emprunteurs garantis et de monopoleurs contraints dans leurs tarifs par l’Etat (tramways, transports maritimes), baissent fortement sans doute du fait des destructions dues à la guerre: ceci amène des sociétés nouvelles (textiles) parmi les émetteurs et impose à un certain nombre d’anciens émetteurs de reprendre massivement leurs émissions.
Il reste que notre champ d’observation est partiel: si un important élargissement sectoriel de la Bourse a lieu durant cette période, qui contribue à la baisse de l’autofinancement global, il reste que la Bourse ne reflète pas la structure de l’économie. Ainsi, les chemins de fer et les banques la dominent vers 1890, les entreprises du secteur de l’énergie, puis les producteurs de biens d’investissement y entrent massivement avant 1914, suivies après la guerre par celles de biens intermédiaires et de consommation.
Outre ces constatations qui éclaircissent le processus historique de modification du taux d’autofinancement macro-économique, de telles données individuelles (ou sectorielles) permettent de vérifier plus strictement certaines des explications des structures de financement envisagées précédemment. Ainsi, on a pu montrer que les faiblesse du système légal et de la législation sur les sociétés, et les problèmes en résultant en matière de contrôle des dirigeants (plus précisément, les craintes des actionnaires ou des obligataires de ne pouvoir empêcher les dirigeants de s’approprier une partie des profits), ont influencé substantiellement l’allocation des capitaux entre entreprises durant l’entre-deux-guerres (même s’ils semblent n’avoir guère d’influence sur le niveau global de l’autofinancement).
Des approches similaires pourraient être mises en œuvre pour les périodes suivantes, malgré le travail important que cela représente. En effet, il est clair que l’importance de l’autofinancement au lendemain de la seconde guerre mondiale résulte autant d’une mainmise par l’Etat sur le système financier entier que d’une profitabilité élevée des entreprises privées ou publiques. La baisse de l’autofinancement résulte par la suite à la fois de la libéralisation qui se traduit par un accès plus libre aux marchés financiers, mais aussi de l’extension des crédits semi-garantis que sont les crédits à moyen terme mobilisables, et du développement de nouveaux secteurs d’entreprises privées qui cherchent en Bourse les ressources pour une croissance rapide, et dont L’Oréal ou Carrefour ont été les symboles.
Une tentative ambitieuse de synthèse fut menée au début des années 1970 par l’INSEE dans sa Fresque historique du système productif (1973). Celle-ci tentait d’apprécier au niveau sectoriel l’articulation entre formes de financement, formes de la concurrence et croissance. Elle mettait en valeur par exemple le rôle de financiers implicites que jouaient certains secteurs vis-à-vis des autres, et l’interaction entre ce rôle et l’autofinancement. Ainsi, les industries de produits intermédiaires et de biens d’investissement se caractérisaient souvent par de forts investissements et donc une forte croissance de la productivité qui, combinés à une forte concurrence (nationale et étrangère) conduisaient à de fortes baisses des prix de leurs produits. Ceux-ci servant de consommations intermédiaires à d’autres secteurs, leurs baisses de prix se répercutaient en baisses de coûts de ces derniers, augmentant d’autant plus la rentabilité de ces secteurs avals que ceux-ci connaissaient une moindre concurrence (spécialement dans le cas des services) et une moindre croissance de la productivité. On pouvait donc contraster un autofinancement faible des secteurs amont, résultant de forts investissements financés par un endettement considérable (et croissant) et l’autofinancement élevé de secteurs avals moins endettés, plus profitables, mais non plus productifs.
De tels travaux montrent bien la complexité des interactions entre secteurs d’activité, qui peuvent transiter aussi bien par le biais de financement directs ou des formes de la concentration que des pouvoirs relatifs de marché affectant les consommations intermédiaires. Malheureusement, ces études n’ont donné lieu à aucun prolongement contemporain, comparatif ou historique, ce qui interdit des conclusions plus générales.
Cet exemple, comme nombre de ceux évoqués précédemment, témoigne du caractère encore peu avancé des travaux sur le financement de l’économie, des difficultés mais aussi de la nécessité de l’articulation entre les niveaux micro, méso et macro-économiques, et de la place à la fois centrale et trop négligée de l’autofinancement dans la dynamique de l’investissement. Si les années récentes ont vu au plan théorique un rééquilibrage se produire qui voit l’autofinancement recouvrer une place positive et non de simple résidu dans l’étude du financement des entreprises, elles n’ont pas vu ce mouvement s’étendre à la macroéconomie, ni réellement aux études empiriques ou historiques. Seules des conjonctures et des exemples sont actuellement disponibles, mais les travaux en cours laissent espérer un progrès substantiel dans un avenir proche.